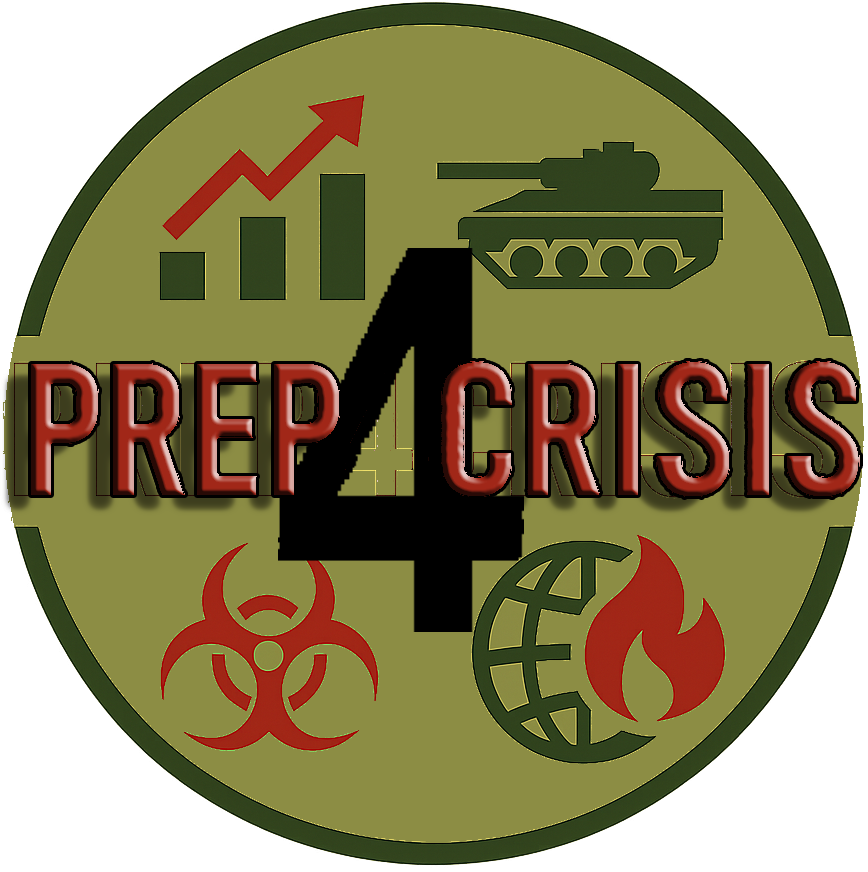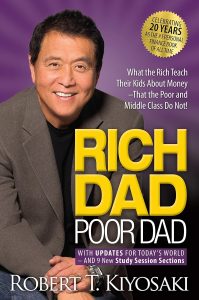Dans cet article, nous allons parler d’un sujet à la fois important et un peu complexe. Pour bien le comprendre, il faut connaître quelques bases de macroéconomie. Nous ferons aussi référence à certains ouvrages que je vous recommande vivement.
Parmi eux, les livres de Robert Kiyosaki, excellents pour découvrir les principes de l’éducation financière, ainsi que Grunch of Giants de Buckminster Fuller, une lecture percutante et éclairante.
Nous vivons une période charnière, et les prévisions que nous allons évoquer sont plutôt sérieuses. Comme souvent, il y a trois types de personnes : ceux qui savent, ceux qui écoutent ceux qui savent, et ceux qui refusent d’écouter — ceux-là n’agiront que quand il sera trop tard.
Pour comprendre ce qui se passe, il faut savoir analyser. Et pour analyser, il faut des outils et des informations. Cet article vise à vous en apporter un peu des deux.
À l’ombre des gratte-ciels, un grondement sourd : celui des rouages du système économique mondial qui grincent
mais peu semblent vouloir écouter ce vacarme prémonitoire. Pourtant, certains tirent la sonnette d’alarme depuis des décennies. Buckminster Fuller, dans Grunch of Giants — acronyme pour Gross Universal Cash Heist (Le gros hold-up) — dénonçait dès 1983 le vol à grande échelle orchestré par les conglomérats financiers. Pour lui, le monde n’est plus dirigé par les peuples, mais par des entités abstraites, invisibles et tout-puissantes : les géants. Et ces géants, affirmait-il, ne connaissent ni scrupules ni frontières.
Trente ans plus tard, c’est Robert T. Kiyosaki, entrepreneur et pédagogue financier à succès, qui reprend ce flambeau incandescent. Dans Second Chance, il affirme que nous vivons non pas une époque de simple turbulence, mais l’antichambre d’un effondrement global. Le “père riche” de son récit, figure de sagesse financière, y prophétise une crise plus grave que celle de 1929, une onde de choc planétaire provoquée par un système truqué — une économie fondée sur la dette, dopée aux injections monétaires, où l’argent est créé sans valeur et la richesse déplacée vers le sommet.
« L’histoire est sur le point de se répéter, mais cette fois, les leçons ne suffiront plus », avertit Kiyosaki, qui voit dans cette crise à venir à la fois un cataclysme pour les masses et une opportunité pour les lucides. Ceux qui ne savent ni lire un bilan, ni comprendre les flux de l’argent, seront les plus exposés. Car, selon lui, l’école n’apprend pas la vraie richesse ; elle forme des salariés, pas des survivants économiques.
Derrière les chiffres lissés, les bilans maquillés et les discours rassurants, se cache une autre réalité,bien plus inquiétante.
Banques centrales et institutions financières : les pyromanes protégés par les extincteurs
En 2008, les banques avaient déclenché la pire crise depuis 1929. En 2025, elles pourraient bien recommencer. Mais cette fois, les avertissements sont nombreux — et ignorés.
Elon Musk lui-même, patron de Tesla, a évoqué dès 2022 un « mauvais pressentiment » sur l’économie mondiale, annonçant une réduction de 10 % des effectifs de son groupe. Dans la foulée, Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, n’a pas mâché ses mots : « un ouragan financier » s’annonce. Charles Gave, Richard Détente et Didier Darcet alertent aussi sur des signaux faibles mais alarmants : l’assèchement du dollar à l’étranger, la flambée durable du prix de l’énergie, et un ralentissement brutal du commerce mondial. Autant d’éléments qui, combinés, créent un cocktail propice à une onde de choc mondiale.
Mais le décor de cette tempête a été planté bien avant. Dès 2006, les signaux avant-coureurs de la crise des subprimes étaient visibles : un marché immobilier en surchauffe, des prêts à taux variables distribués à la chaîne, une montée des défauts de paiement. L’effondrement de Lehman Brothers en septembre 2008 marquera le début officiel de la débâcle, mais tout était déjà en place. Résultat : des marchés effondrés, une récession mondiale, des millions de foyers ruinés… et des banques renflouées.
En 2020, le Covid-19 a apporté un nouveau choc. Les marchés se sont écroulés en quelques jours, mais les banques centrales sont intervenues massivement, inondant les marchés de liquidités. Et là encore : un rebond éclair pour les actions… et des banques rassasiées.
La vraie folie : celle des banques centrales
Depuis 2008, les banques centrales ont adopté une stratégie d’intervention quasi-permanente dans l’économie. Taux d’intérêt au plancher, rachats massifs d’actifs, quantitative easing : la planche à billets ne s’est jamais arrêtée. C’est précisément ce que dénoncent Patrick Artus et Marie-Paule Virard dans leur ouvrage La folie des banques centrales : cette fuite en avant monétaire a fini par créer plus de volatilité que de stabilité, plus d’instabilité que de croissance, plus de dépendance que de solution.
Le problème ? Ces injections massives de liquidités virtuelles qui ne circulent pas dans l’économie réelle. Elles naviguent d’un actif financier à l’autre, provoquant des bulles spéculatives et des crashs à répétition. L’argent bon marché gonfle artificiellement les valorisations des entreprises, mais n’incite plus à investir durablement.
Le cercle vicieux
Pire encore : ces politiques monétaires expansionnistes sont devenues irréversibles. Car si les banques centrales arrêtent d’acheter des obligations et laissent les taux remonter, l’ensemble du système (États, banques, entreprises, marchés) vacillera. Un relèvement brutal des taux provoquerait des pertes massives sur les portefeuilles obligataires (notamment pour les assureurs-vie et les banques), une explosion du coût de la dette, et une contraction immédiate de l’économie. Autrement dit : elles ne peuvent plus arrêter sans tout faire s’écrouler.
Depuis la fin de l’étalon-or en 1971, le dollar a perdu 97 % de sa valeur. En parallèle, jamais autant de monnaie n’a été injectée dans le système. Mais plutôt que de créer de la croissance, cela a produit de l’inflation, des bulles financières, et une économie mondiale rendue vulnérable aux moindres chocs.
Un jeu truqué, des perdants désignés
Mais une chose ne change jamais : dans ce casino monétaire mondialisé, les banques ne perdent jamais. Leur position est unique : lorsqu’elles prennent des risques, elles encaissent. Lorsqu’elles échouent, elles sont secourues.
On l’a vu avec Goldman Sachs, renflouée en 2008. On l’a revu en 2020, à travers le soutien massif aux marchés. On le verra encore demain, lors du prochain krach.
La vraie question n’est plus “va-t-il y avoir une crise ?”, mais « comment si préparer ?«
Islande : la petite nation qui a dit non au système
À l’heure où les grandes puissances s’enlisent dans des spirales de dettes publiques, de renflouements bancaires à répétition et d’austérités imposées sous la bannière du FMI, un petit pays de l’Atlantique Nord a pris un virage radical. L’Islande, touchée de plein fouet par la crise de 2008, a fait un choix que peu de nations occidentales ont osé envisager : laisser ses banques faire faillite, traduire en justice ses responsables financiers et dire non à la socialisation des pertes.
En 2008, le monde vacille. Lehman Brothers tombe, les marchés paniquent, et les États injectent des milliards pour sauver leurs institutions bancaires. L’Islande, elle, refuse de suivre la chorégraphie imposée par Wall Street. En octobre, ses trois principales banques — Kaupthing, Glitnir, Landsbanki — s’effondrent sous le poids de leurs dettes, représentant alors près de dix fois le PIB du pays. La couronne islandaise chute de 85 %, l’inflation explose à 15 %, et le chômage monte en flèche.
Le choc est brutal. Mais au lieu de renflouer le privé avec l’argent public, Reykjavik dit stop. Une décision historique est prise : nationaliser les banques en faillite, protéger les déposants locaux… et ignorer les créanciers étrangers, notamment britanniques et néerlandais. Une gifle symbolique au système financier mondialisé. Le Premier ministre britannique d’alors, Gordon Brown, accuse même l’Islande de terrorisme financier. En 2010, le peuple islandais rejette par référendum — à plus de 90 % — un plan qui aurait obligé chaque citoyen à rembourser la dette d’Icesave, une banque en ligne ayant fait naufrage au Royaume-Uni.
Pendant que les autres pays sauvaient leurs banquiers, l’Islande renversait les siens. La « révolution des casseroles » de 2009, un soulèvement pacifique et sonore mené par les citoyens, balaie le gouvernement conservateur. Une nouvelle Constitution est rédigée par une assemblée citoyenne, bien qu’elle reste encore inaboutie.
À court terme, le coût est élevé. Récession, exode massif de jeunes diplômés, relations diplomatiques tendues. Mais à moyen terme, l’Islande rebondit. En 2011, elle renoue avec la croissance. En 2016, elle affiche un taux de croissance de 7,2 %, le plus élevé de l’OCDE, portée par le boom du tourisme et une consommation intérieure soutenue. En 2015, le FMI annonce que l’Islande a remboursé intégralement ses dettes. En 2016, même le différend d’Icesave avec Londres est réglé.
La trajectoire islandaise témoigne d’un courage politique inhabituel : celui de désobéir aux dogmes économiques. Là où d’autres pays ont creusé leur dette publique pour sauver des banques coupables, l’Islande a refusé d’endetter ses générations futures pour couvrir les erreurs du privé.